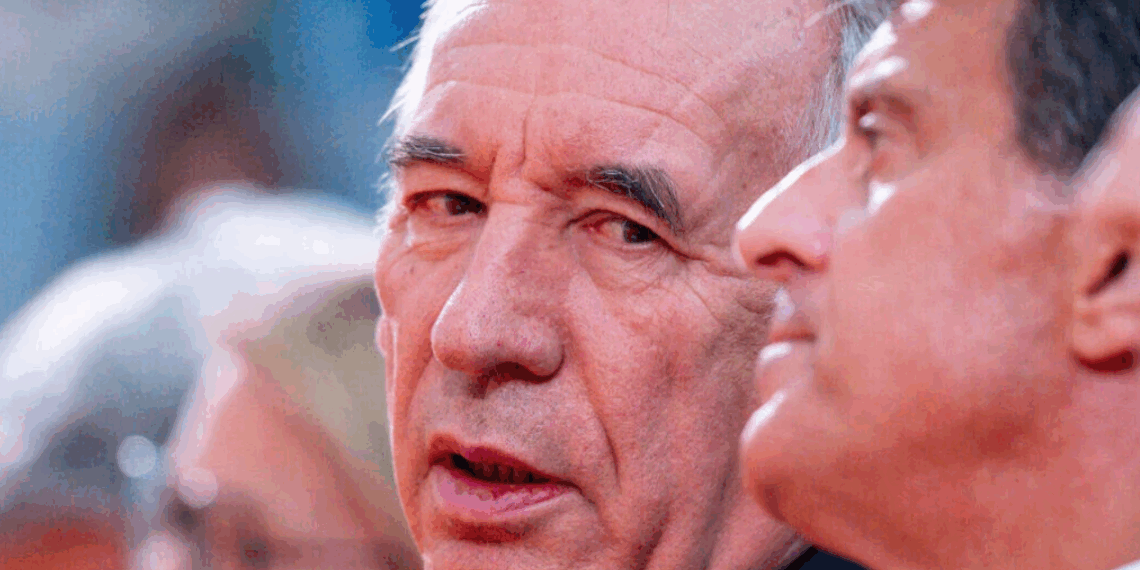On le croise sur toutes les portes, dans les gares comme dans les restaurants, sans vraiment y prêter attention.

Pourtant, derrière ces deux lettres si familières — « WC » — se cache une histoire étonnante, entre innovations victoriennes, pudeur linguistique et universalité pratique. Voici comment un simple sigle est devenu un mot du quotidien partout dans le monde.
“Water Closet” : le chic anglais du XIXᵉ siècle
Le terme « WC » vient de l’expression anglaise “Water Closet”, littéralement « placard à eau ». Au XIXᵉ siècle, l’apparition de la chasse d’eau révolutionne l’hygiène domestique. En Angleterre, cette invention était considérée comme un signe de modernité et de confort bourgeois.
Les toilettes, installées à part dans une petite pièce fermée, étaient donc un “closet” (placard) doté d’eau courante — une rareté à l’époque. Très vite, les Anglais aisés adoptent le terme “Water Closet” pour désigner cette innovation hygiénique.

Avec le temps, les initiales “WC” s’imposent comme une abréviation élégante et pratique, gravée sur les plaques des hôtels, des gares ou des wagons de train à travers l’Europe. Ironie du sort : peu de gens songent aujourd’hui à un placard en poussant la porte d’un “WC”…
Pourquoi ne pas dire simplement “toilettes” ?
En français, le mot “toilettes” vient du vieux mot “toile”, qui désignait à l’origine le tissu utilisé pour la toilette du visage et des mains. Il s’est ensuite étendu à la pièce où l’on se lavait ou se préparait.
Mais dans les lieux publics, le terme “WC” a longtemps été préféré pour sa neutralité et sa clarté universelle.
Quant à “salle de bains”, il prête souvent à confusion : historiquement, cette pièce contenait une baignoire, ce qui n’est évidemment pas le cas des toilettes publiques.
Dans les pays anglophones, les termes varient : “restroom” (pièce pour se reposer), “bathroom” (même sans baignoire) ou encore “lavatory” (lieu pour se laver). De quoi provoquer quelques quiproquos chez les voyageurs francophones en quête d’un petit coin discret !
Des appellations du monde entier

Chaque langue a sa façon, parfois poétique, parfois humoristique, d’évoquer ce lieu indispensable :
En Angleterre, on dit souvent “loo”, un mot familier et affectueux.
PUBLICITÉ:Au Canada, on jongle entre “toilettes” et “bathroom”.
En Allemagne, c’est “Toilette” ou “WC”, selon le contexte.
En Russie, le mot signifie littéralement « pièce sans fenêtre ».
PUBLICITÉ:En espéranto, les toilettes se disent “necesejo”, c’est-à-dire « le lieu nécessaire » — une jolie trouvaille linguistique.
Certaines cultures contournent même le mot direct, préférant des euphémismes élégants comme “petit coin”, “commodités” ou “cabinet”.
Une question de plomberie… et de pudeur
À la fin du XIXᵉ siècle, avoir des toilettes à l’intérieur de la maison était un privilège réservé aux plus aisés.
Les habitations populaires disposaient encore de latrines à l’extérieur, souvent communes.
Ce n’est qu’au XXᵉ siècle que la salle de bain et les toilettes ont commencé à cohabiter sous le même toit. Mais la distinction linguistique est restée : “WC” pour les sanitaires, “salle de bains” pour l’hygiène corporelle.
Cette pudeur héritée du passé explique pourquoi le sigle “WC” a été préféré au mot direct “toilettes” dans les lieux publics, jugé trop intime ou trivial à l’époque.