Pilier essentiel du droit du travail, le Smic encadre les rémunérations les plus basses afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés.

Héritier du Smig instauré en 1950, il s’est transformé au fil des décennies pour devenir un levier central de lutte contre la pauvreté et un baromètre économique majeur. Le Smic, acronyme de Salaire interprofessionnel minimum de croissance, constitue aujourd’hui la base légale d’un salaire en France. Créé en 1950 sous le nom de Smig, il visait à répondre aux difficultés économiques de l’après-guerre et à protéger les travailleurs les plus modestes. Depuis, ses objectifs ont évolué, mais trois missions demeurent essentielles : garantir le pouvoir d’achat, lutter contre la pauvreté et accompagner l’évolution du salaire moyen. La France n’est pas isolée : la grande majorité des pays européens – 22 sur 27 – ont instauré un salaire minimum national.
Comment est déterminé le montant du Smic ?
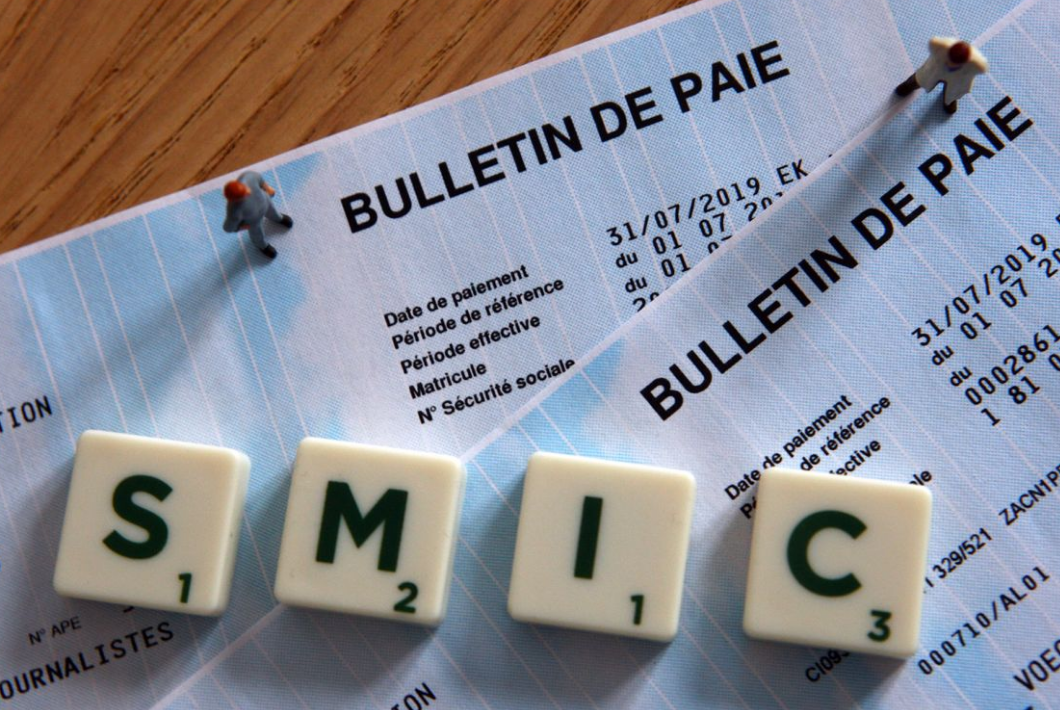
Le montant du Smic résulte d’un mécanisme précis qui combine salaire net et cotisations sociales, destinées notamment à financer le chômage ou la retraite. Ce salaire n’est jamais figé, car il suit l’évolution du coût de la vie : son calcul repose sur l’inflation et sur la croissance. L’indexation automatique s’appuie d’abord sur la progression de l’indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac, pour les 20 % de ménages les plus modestes. Ce choix n’est pas anodin : les dépenses en énergie et en alimentation pèsent davantage dans leurs budgets, et cet indice évolue donc plus vite que celui de l’ensemble des ménages. La seconde référence concerne la hausse annuelle du salaire horaire moyen des ouvriers et employés (SHBOE), évaluée par la Dares. En cas d’inflation forte ou de volonté politique, des revalorisations exceptionnelles peuvent également intervenir en cours d’année.
Une progression régulière depuis plus d’une décennie

Depuis 2012, le Smic brut mensuel n’a cessé d’augmenter, suivant les tensions économiques et les poussées successives d’inflation. Les revalorisations successives ont renforcé son rôle d’amortisseur social, permettant aux salaires les plus faibles de suivre, au moins en partie, les évolutions économiques nationales. Cette dynamique contribue à limiter l’appauvrissement des ménages les plus fragiles, même si elle pèse parfois sur les entreprises à faibles marges.
Qui perçoit le Smic en France ?
En 2024, près de 3,1 millions de personnes, soit 17 % des salariés, sont rémunérées au Smic. Cette proportion a presque doublé depuis les années 1990. Les femmes y sont particulièrement représentées, notamment en raison de leur présence plus importante dans l’emploi à temps partiel, secteur où le recours au salaire minimum est plus fréquent. Les professions les plus exposées sont la restauration et les services à la personne. À l’inverse, les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’industrie pharmaceutique comptent très peu de salariés au Smic.











