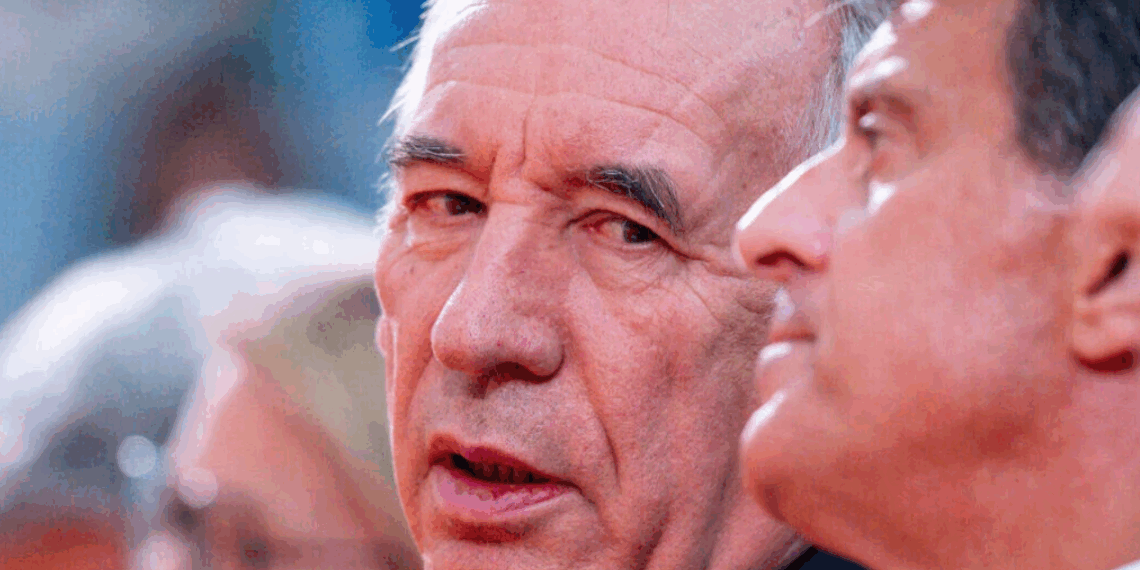Le tribunal administratif de Marseille a tranché en faveur de la liberté artistique. Après une polémique nationale, la ville a été contrainte de reprogrammer la diffusion du film religieux « Sacré-Cœur », initialement annulée au nom de la laïcité. Une décision qui relance le débat sur la frontière entre foi et espace public.
Le film « Sacré-Cœur », présenté comme un docu-fiction célébrant la foi chrétienne et la figure du Christ, connaît un succès inattendu depuis sa sortie début octobre, attirant déjà près de 200 000 spectateurs. Pourtant, sa projection prévue au château de la Buzine, un établissement municipal marseillais, avait été brutalement annulée par la mairie quelques heures avant la séance.
Dirigée par une coalition de gauche et de société civile, la municipalité avait invoqué la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, estimant qu’un film à caractère religieux ne devait pas être diffusé dans un lieu public géré par la ville. Une décision perçue par certains comme une défense de la laïcité, mais dénoncée par d’autres comme une atteinte à la liberté d’expression.
La justice administrative rappelle les limites de la laïcité
Saisi en urgence par le sénateur Stéphane Ravier et les réalisateurs du film, Sabrina et Steven J. Gunnell, le tribunal administratif de Marseille a estimé, dans une ordonnance de six pages, que l’annulation de la projection constituait une “atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la création artistique”.
Le juge a souligné que la diffusion d’un film à caractère religieux ne viole pas, en soi, le principe de laïcité, tant qu’elle ne traduit pas une préférence confessionnelle de la part de la collectivité. En d’autres termes, projeter “Sacré-Cœur” dans une salle municipale ne revient pas à subventionner un culte, mais à permettre la libre circulation d’une œuvre artistique.
Une censure jugée injustifiée
Dans ses conclusions, le tribunal a précisé que la déprogrammation avait restreint de manière disproportionnée l’accès du public au film, qui n’était alors diffusé que dans une seule salle de Marseille. Le maire aurait donc privé une partie des spectateurs d’une œuvre en plein essor, sans justification juridique suffisante.
Stéphane Ravier, à l’origine du recours, s’est félicité de cette victoire en déclarant : « C’est une grande satisfaction. Le maire a fait preuve de censure, il n’y avait pas de promotion d’une religion, mais une œuvre artistique. » Le couple de réalisateurs, de leur côté, y voit une reconnaissance du droit à la création spirituelle dans une société pluraliste. Face au verdict, la mairie de Marseille a indiqué dans un bref communiqué prendre acte de la décision et s’engager à reprogrammer le film “comme initialement prévu”. La projection pourra donc avoir lieu dans les jours à venir au château de la Buzine.