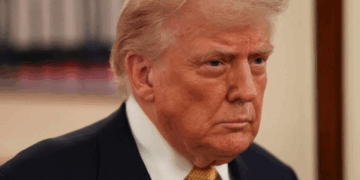Près de cinq ans après l’apparition du Covid-19, l’heure est au bilan. Si les vaccins ont permis de freiner la pandémie, des études récentes révèlent l’existence d’effets secondaires potentiellement graves, relançant le débat sur la vaccination massive menée dans l’urgence.
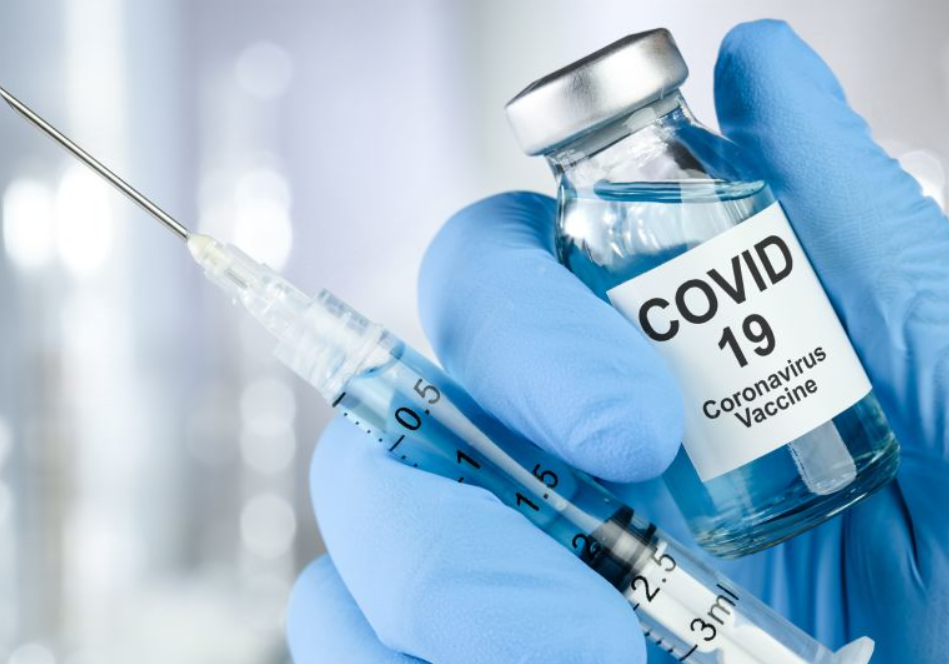
Fin 2019, un virus inconnu surgit à Wuhan et se répand à grande vitesse. En quelques semaines, l’OMS sonne l’alerte : une pandémie mondiale est en marche. Le Covid-19, hautement contagieux, va bouleverser tous les repères et faire vaciller les systèmes de santé du globe.
Premiers cas et premières victimes en France
C’est en janvier 2020 que la France diagnostique ses premiers cas. Moins d’un mois plus tard, des patients succombent au virus. La menace se précise. L’épidémie s’installe durablement, forçant les autorités à revoir leurs priorités sanitaires.
Le confinement, un tournant historique

Le 17 mars 2020, le pays se met à l’arrêt complet. Un confinement général est décrété, laissant les rues désertes et les esprits inquiets. Deux mois plus tard, le masque devient obligatoire, tandis qu’une course mondiale au vaccin est lancée, impliquant les plus grands laboratoires.
Une réponse vaccinale rapide, mais controversée
En un temps record, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson développent leurs vaccins. Si cette réactivité est saluée, elle suscite aussi des interrogations sur la sécurité et les effets à long terme des sérums injectés à des millions de personnes.
Des effets secondaires désormais identifiés

Cinq ans plus tard, les médecins disposent d’un recul suffisant. Ils observent une fréquence notable d’effets indésirables : hypertension, troubles menstruels, réactions allergiques, myocardites ou encore péricardites. Des pathologies parfois sévères, mais dont la causalité reste encore discutée.
Un lien encore débattu entre vaccin et maladies graves
Le monde médical est divisé : certains attribuent ces affections au vaccin, d’autres jugent qu’il faut davantage de preuves pour établir un lien direct. Une étude récente semble toutefois peser dans le débat, en s’appuyant sur des données massives.
Une enquête à l’échelle mondiale
Réalisée par le Global Vaccine Data Network, cette étude a suivi plus de 99 millions de personnes dans huit pays, dont la France. Publiée dans Vaccine, elle alerte sur certains risques associés aux premières doses, notamment avec le vaccin d’AstraZeneca.
Les vaccins les plus administrés et leurs profils

Selon l’étude, la majorité des vaccinés avaient entre 20 et 59 ans, et la France figure parmi les pays ayant administré le plus grand nombre de doses. Les données concernent principalement les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, utilisés massivement depuis 2021.
Guillain-Barré et thromboses : des cas en hausse
Les chercheurs ont constaté une hausse significative du syndrome de Guillain-Barré (atteinte neurologique paralysante) et des thromboses veineuses cérébrales après injection du vaccin d’AstraZeneca. Des pathologies rares mais graves, ayant conduit certains patients à l’hospitalisation, voire à la fin d’activités physiques comme ce fut le cas du basketteur Victor Wembanyama.
Myocardites, péricardites : le risque existe
L’étude montre également que tous les vaccins testés augmentent le risque d’inflammation du cœur de façon « significative ». Ces atteintes, connues dès 2021, font aujourd’hui l’objet d’une surveillance renforcée, les chercheurs appelant à de nouvelles recherches pour mieux comprendre ces réactions.