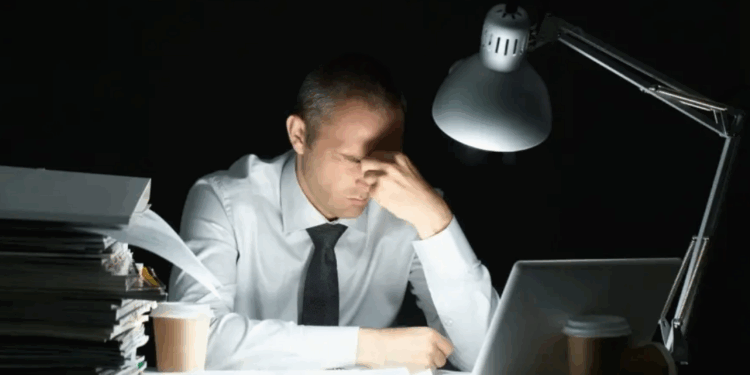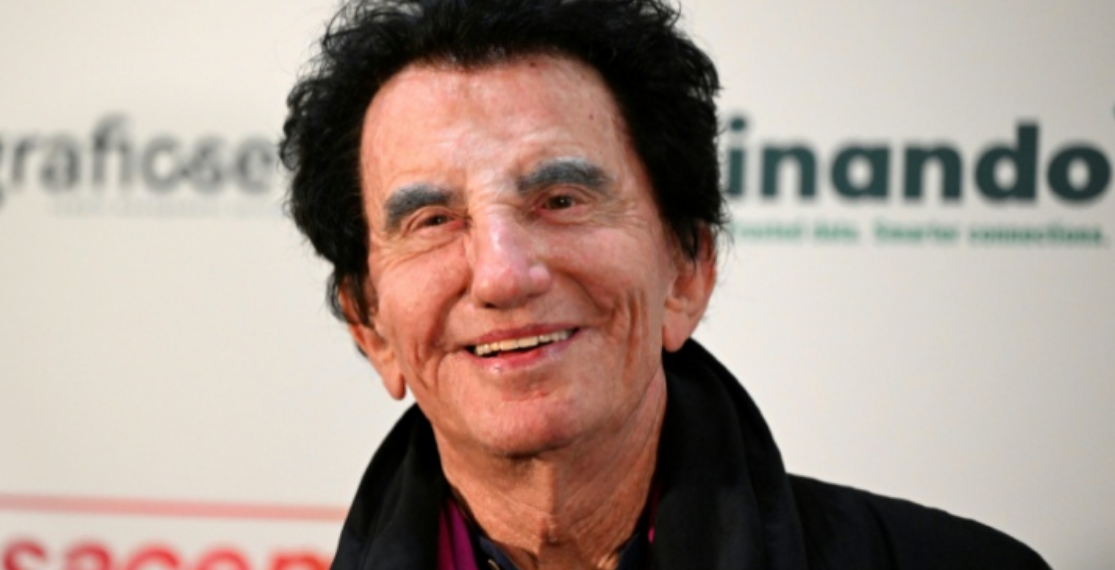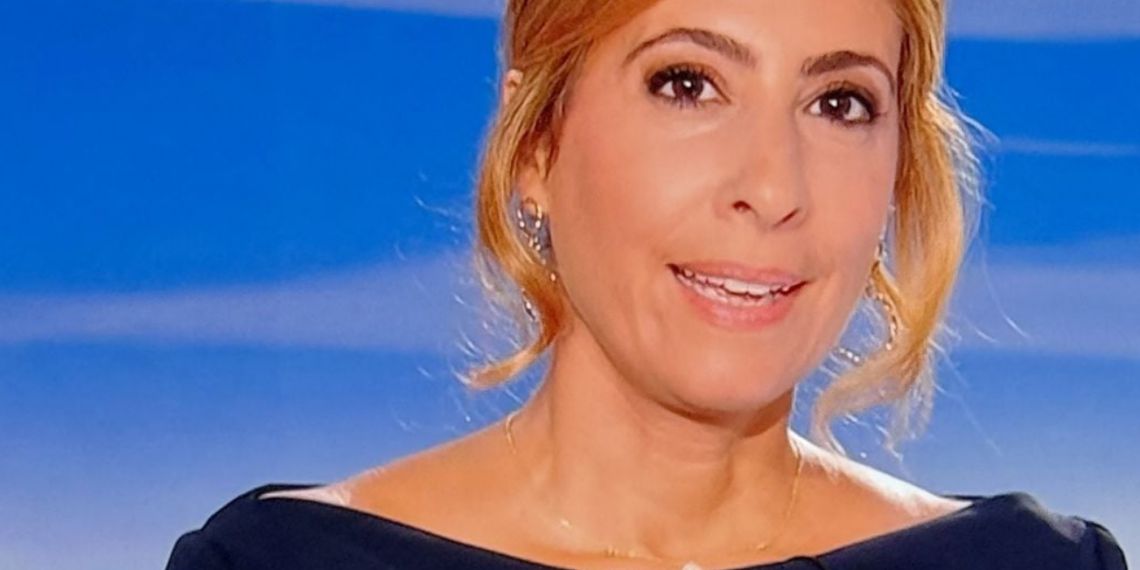Une récente décision de la Cour de cassation bouleverse l’interprétation du repos hebdomadaire en France.

En autorisant, sous conditions, jusqu’à douze jours de travail consécutifs, les magistrats redéfinissent un équilibre déjà fragile entre souplesse organisationnelle et protection de la santé des salariés.
Dans un arrêt rendu le 13 novembre, la Cour de cassation a tranché un débat ancien : un salarié peut légalement travailler plus de six jours d’affilée, dès lors qu’il bénéficie d’un jour de repos dans chaque semaine civile. Autrement dit, la règle du Code du travail – « pas plus de six jours par semaine » – ne concerne pas un cycle continu de sept jours, mais bien la période allant du lundi au dimanche.
Jusqu’à douze jours de travail non-stop
Ce revirement découle d’un litige opposant un directeur des ventes à son entreprise. L’homme avait travaillé onze puis douze jours consécutifs lors de salons professionnels. La cour d’appel lui avait donné raison et condamné l’employeur, mais la Cour de cassation a cassé ce jugement. Pour elle, un salarié peut enchaîner du mardi d’une semaine au samedi de la suivante, s’il dispose d’un repos le lundi de la première semaine et le dimanche de la seconde. Cette clarification met fin à un flou juridique et accorde aux entreprises une flexibilité accrue, susceptible de transformer profondément l’organisation du travail.
Des secteurs particulièrement concernés

L’hôtellerie-restauration, l’événementiel, le commerce ou les activités saisonnières pourraient rapidement s’emparer de cette décision. Pour ces secteurs soumis à des pics d’activité, enchaîner douze jours consécutifs devient désormais un levier supplémentaire de gestion du personnel. Mais cette pratique s’accompagne de risques bien réels pour les travailleurs, notamment dans les métiers physiquement exigeants.
Des risques importants pour la santé et la sécurité
Pour de nombreux professionnels des ressources humaines, cette nouvelle possibilité n’est pas sans danger. « Je pousse l’équipe, je risque un accident du travail », alerte ainsi Renaud de Kergolay, DRH d’une PME industrielle, évoquant un dilemme permanent entre productivité et sécurité. Selon lui, la promesse de souplesse dissimule une « dette humaine » faite de fatigue, d’erreurs, d’absentéisme et de pertes de compétences. « La performance industrielle commence là où la fatigue s’arrête », estime-t-il.
Le spectre du burn-out et des risques psychosociaux

Même son de cloche du côté des spécialistes en gestion du personnel. La formatrice Christel Pontié rappelle qu’un salarié épuisé, même dans un cadre légal, reste exposé aux risques psychosociaux, aux conflits internes ou au burn-out. Travailler douze jours consécutifs peut certes répondre à une urgence économique, mais crée, selon elle, un terrain propice à l’usure professionnelle et à l’absentéisme.
Une flexibilité encadrée et non sans limites
Le service public précise néanmoins qu’une convention collective peut déroger à cette règle jurisprudentielle, selon les spécificités d’un secteur. Par ailleurs, l’employeur demeure soumis à une obligation essentielle : garantir la santé et la sécurité de ses salariés, en vertu de l’article L.4121-1 du Code du travail. Autrement dit, la possibilité d’enchaîner douze jours de travail n’autorise en rien la mise en danger des employés.