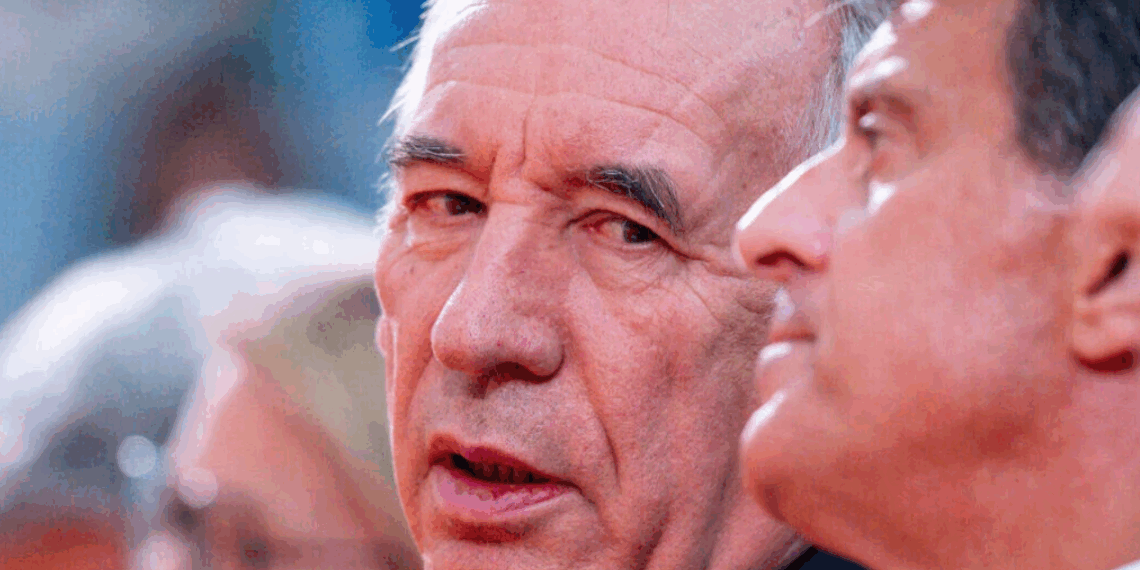Le procès de Dahbia Benkired, accusée du meurtre atroce de la petite Lola, ravive une plaie profonde dans la société française. Au-delà du drame humain, cette affaire relance un débat aussi ancien que passionné : celui du rétablissement de la peine de mort.

Le vendredi 17 octobre s’est ouvert devant la cour d’assises de Paris le procès de Dahbia Benkired, ressortissante algérienne de 27 ans, accusée d’avoir violé, torturé et tué Lola Daviet, 12 ans, en octobre 2022. Ce crime, commis dans le 19ᵉ arrondissement de Paris, avait provoqué une onde de choc nationale.
Sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) au moment des faits, l’accusée est depuis devenue le symbole d’une double colère : celle contre une violence insoutenable envers un enfant et celle contre les défaillances administratives qui ont précédé le drame.
L’émotion populaire, encore vive trois ans après, a fait de ce procès un moment de catharsis collective, mais aussi un point de tension politique et moral.
Une peine de perpétuité incompressible en débat

En théorie, Dahbia Benkired risque la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la sanction la plus lourde prévue par le code pénal français depuis l’abolition de la peine de mort en 1981. Cette peine, rarissime, implique aucune possibilité de libération avant 30 ans au minimum.
Une pétition lancée par l’Institut pour la Justice a d’ailleurs recueilli plus de 56 000 signatures, réclamant que cette sanction soit appliquée sans indulgence. « Il faut faire en sorte que Dahbia Benkired ne sorte jamais de prison », a martelé Pierre-Marie Sève, directeur de l’institution, sur Europe 1.
Ce type de condamnation, prévu pour les crimes comportant viol, torture ou actes de barbarie sur mineur, correspond parfaitement aux faits reprochés à l’accusée. Pourtant, pour une partie de l’opinion, même la perpétuité ne suffit pas à réparer l’horreur du crime.
Le retour du spectre de la peine de mort
Sur les réseaux sociaux, la question du rétablissement de la peine capitale a ressurgi avec force. De nombreux internautes expriment leur indignation face à ce qu’ils perçoivent comme une justice trop clémente. « Je suis pour la peine de mort dans tous les crimes contre les enfants », écrit un utilisateur sur X (ex-Twitter), une opinion relayée des milliers de fois.
Un sondage en ligne mené par un internaute confirme cette tendance : 80,2 % des 162 votants se disent favorables au rétablissement de la peine de mort dans ce type de cas. Si ce chiffre n’a pas de valeur scientifique, il traduit néanmoins le profond désarroi d’une partie de la population, choquée par la nature du crime et frustrée par le cadre légal actuel.

Une France toujours divisée sur la question
La France a aboli la peine de mort en 1981, sous l’impulsion de Robert Badinter, alors garde des Sceaux, qui voyait dans cette réforme une victoire humaniste majeure. Mais depuis plusieurs années, le débat resurgit à chaque affaire criminelle impliquant des enfants.
Certains internautes vont jusqu’à évoquer le nom de Badinter, aujourd’hui décédé, en estimant que « l’homme qui avait aboli la peine de mort doit se retourner dans son caveau ». Une formule provocante qui illustre la fracture persistante entre partisans de la justice implacable et défenseurs des valeurs abolitionnistes.
Pour d’autres, rétablir la peine capitale serait une régression, un symbole de vengeance plutôt que de justice. Ces voix rappellent que la France est liée à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui interdit explicitement la peine de mort.