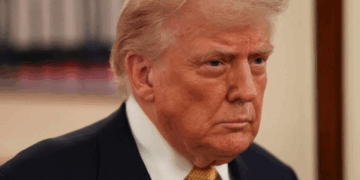Plus de 80 ans après leur déportation en Allemagne dans le cadre du Service du travail obligatoire (STO), deux anciens requis centenaires se sont vu refuser une ultime demande d’indemnisation par la justice française.

Une décision qui relance le débat sur la reconnaissance symbolique et matérielle de ceux que l’Histoire a trop souvent laissés dans l’ombre. Ce mardi 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a tranché : les demandes d’indemnisation formulées par Albert Corrieri, 103 ans, et Erpilio Trovati, 102 ans, sont rejetées. Les deux hommes réclamaient respectivement 43 200 euros et 33 400 euros à l’État français, au titre du travail forcé qu’ils ont effectué entre 1943 et 1945 dans des usines allemandes sous le régime nazi.
Leur revendication s’appuyait sur une logique simple : réclamer un salaire pour le travail accompli, estimé à 10 euros de l’heure, pour des mois d’asservissement imposé par le gouvernement de Vichy. Mais la cour s’est fondée sur la loi du 14 mai 1951, qui avait instauré une indemnité forfaitaire pour les personnes contraintes au travail dans les pays ennemis.
Une décision fondée sur une ancienne loi et sur la prescription

Dans un communiqué, la cour rappelle que la loi de 1951 avait déjà pour objectif de réparer les préjudices de toute nature subis par les requis du STO, y compris les dommages financiers. L’avocate générale, lors de l’audience du 24 juin, avait elle aussi insisté sur le fait que cette indemnisation globale ne pouvait aujourd’hui être rediscutée, en invoquant notamment la prescription du droit à contester cette indemnité, plus de 70 ans après les faits.
Mais pour l’avocat des plaignants, Me Michel Pautot, cette lecture est réductrice. Il soutient que la loi ne prévoit aucunement un dédommagement pour les heures de travail effectives, mais se concentre sur les blessures et séquelles physiques ou psychologiques. « Il n’est pas logique de ne pas avoir accordé le paiement du salaire de ces déportés », a-t-il affirmé dans un communiqué, dénonçant une décision qui ne prendrait pas la pleine mesure du préjudice subi.
Un combat plus symbolique que financier

Pour Albert Corrieri, ce combat est avant tout une affaire de mémoire et de justice morale. Employé dans un restaurant du Vieux-Port à Marseille avant sa déportation, il avait été envoyé à 20 ans dans une usine allemande de charbon à Ludwigshafen. Il y conserve une blessure au bras causée par un bombardement allié, qui tua l’un de ses camarades. Aujourd’hui, il le répète : « l’argent, tant pis si on ne me le donne pas », mais il veut aller au bout de son engagement.
Son avocat appelle désormais à la création d’un fonds d’indemnisation spécifique, estimant que le STO constitue un crime contre l’humanité encore insuffisamment reconnu. Selon l’Association nationale pour la mémoire du travail forcé, il ne resterait plus qu’une poignée de survivants du STO en France, peut-être une dizaine à peine.
Entre 1943 et 1945, près de 650 000 Français ont été contraints de partir travailler en Allemagne pour soutenir l’effort de guerre nazi. Pendant longtemps, ces hommes ont été les oubliés de la mémoire nationale, souvent considérés comme collaborateurs ou lâches, en opposition aux résistants. Ce n’est que tardivement que leur situation a été reconnue par les institutions, mais sans mesure aussi visible que celle accordée aux déportés raciaux ou politiques.