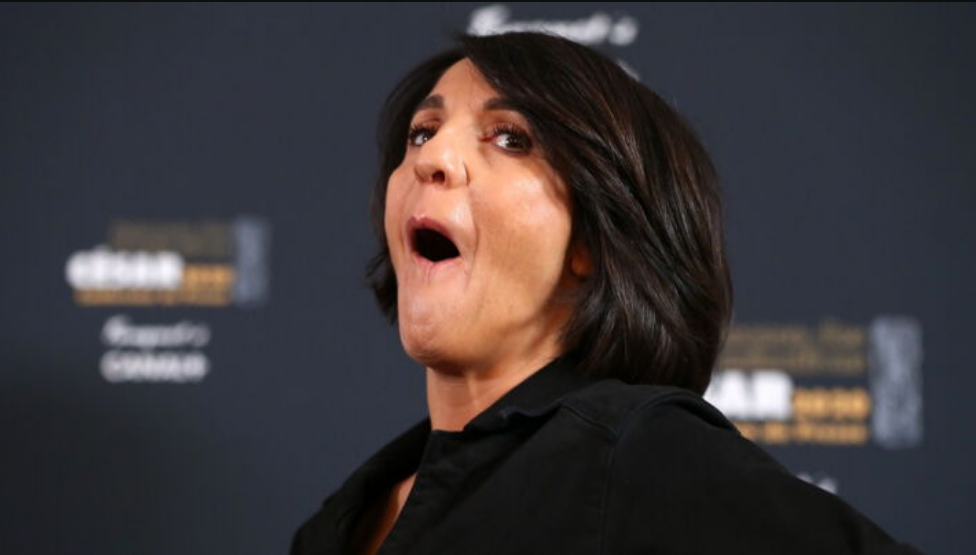Le rejet de la réforme de l’abattement fiscal des retraités marque un nouveau tournant dans les débats budgétaires.

En quelques heures, l’Assemblée nationale a mis fin à un projet qui devait redistribuer les avantages fiscaux, mais dont les conséquences, jugées injustes pour certains retraités, ont créé une fracture politique majeure.
La séance du jeudi 13 novembre a été décisive : les députés ont rejeté la réforme de l’abattement fiscal des retraités proposée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances. Avec 213 voix pour la suppression de l’article concerné et seulement 17 contre, l’hémicycle a affiché un blocage frontal. Ce rejet, acté après une première suppression en commission, réunit un front large : gauche, Rassemblement national, députés LR et ciottistes. La réforme était pourtant un marqueur du gouvernement Lecornu II, héritée d’une proposition de François Bayrou visant à transformer l’abattement de 10 % en un forfait fixe de 2.000 euros par foyer fiscal.
Les objectifs initiaux : simplifier, recentrer, rééquilibrer

L’exécutif défendait une idée simple : l’abattement de 10 %, conçu à l’origine pour couvrir les frais professionnels, ne serait plus adapté une fois à la retraite. Un forfait unique de 2.000 euros par foyer devait remplacer ce mécanisme. Pour le gouvernement, cette évolution permettait d’alléger l’impôt pour les pensions les plus modestes et de corriger ce qu’il jugeait comme un dispositif devenu incohérent et coûteux, à hauteur de 4,5 milliards d’euros selon la Cour des comptes. En conservant le système actuel, Bercy estime le surcoût pour l’État à 1,2 milliard d’euros par rapport au forfait envisagé.
Une réforme favorable aux petites retraites, mais pénalisante au-delà de 20.000 euros
Sur le papier, le forfait de 2.000 euros profitait davantage aux retraités percevant des pensions modestes. Par exemple, un couple touchant 5.000 euros chacun par an aurait obtenu un abattement d’un total de 4.000 euros, contre 1.000 euros actuellement. Mais la mécanique devenait désavantageuse dès 20.000 euros de pension annuelle pour une personne seule — soit environ 1.666 euros par mois, seuil pointé par le député LFI Aurélien Le Coq. Au-delà, le forfait devenait inférieur à l’abattement de 10 % : ainsi, un retraité gagnant 50.000 euros par an perdait plus de 2.000 euros d’abattement fiscal. C’est cette bascule qui a suscité la colère d’une grande partie des parlementaires, estimant que les classes moyennes retraitées étaient injustement ciblées.
Un débat politique tendu autour des gagnants et des perdants

Pour défendre la réforme, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a insisté sur la redistribution opérée par le dispositif : un quart des foyers retraités auraient bénéficié d’une baisse d’impôt, et 84 % du rendement aurait été assuré par les 20 % les plus aisés. Un argument qui n’a pas suffi à convaincre les députés, malgré le soutien de Guillaume Kasbarian, qui rappelait que les retraités profitent déjà de crédits d’impôt plus élevés que les actifs. Le rejet massif révèle le malaise autour de l’équité fiscale entre catégories de retraités.
Au cœur des préoccupations : l’impact potentiel de cette réforme sur les aides sociales. Aujourd’hui, l’abattement de 10 % est communiqué aux CAF pour calculer l’éligibilité aux APL. Le député Nicolas Sansu a alerté sur l’absence totale d’informations concernant l’application du nouvel abattement forfaitaire dans ces calculs. La question est cruciale : une modification pourrait faire gagner ou perdre des droits à certains foyers. La ministre a néanmoins assuré que 625.000 foyers auraient été gagnants en APL, pour un coût de 210 millions d’euros pour l’État, sans détailler la méthode utilisée.