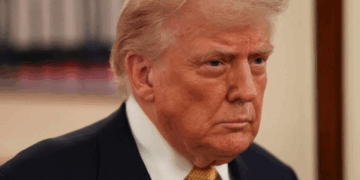Dans un geste audacieux et symbolique, Sasha Zhoya, jeune athlète français et spécialiste du 110m haies, a marqué les esprits lors des essayages pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Choix vestimentaire inattendu : il a opté pour une jupe, brisant les conventions et illustrant un pas de plus vers la fluidité de genre dans le monde de la mode sportive.
Lors de l’émission « Au cœur des Jeux », diffusée sur France 2, Sasha Zhoya est apparu pour la première fois en jupe, associée à une veste, durant les préparatifs de la grande cérémonie.
Sa réaction, teintée de surprise et d’assurance, traduit bien le caractère progressiste de son choix : « Si les femmes ont le droit de mettre le pantalon, ça peut être bien si les hommes ont aussi le choix de mettre la jupe. 2024 ! On peut mettre tout. Il n’y a pas de hommes/femmes dans la mode maintenant. »
Cette démarche de Zhoya s’inscrit dans un contexte plus large de discussions sur les codes vestimentaires dans le sport et au-delà, rappelant le récent débat autour des santiags à talon portées par le footballeur Jules Koundé.
Le clip de Zhoya en jupe a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur X (ex-Twitter), où il a été visionné près de 400 000 fois, suscitant des discussions animées et globalement positives sur la fluidité des genres.
Passion pour la mode et l’expression personnelle
Zhoya n’est pas seulement un athlète ; il est également un passionné de mode. Ambassadeur pour Dior depuis juin, il a figuré en couverture de la première édition française du magazine de mode masculine Icon.
Sur Instagram, il partage régulièrement sa vision de la mode comme un art : « Pour moi, les athlètes sont des artistes… Je suis fasciné par le processus de création. Partir d’une idée, d’un mouvement et essayer de tendre vers l’excellence que ce soit dans la création d’un vêtement ou d’une performance. »
Malgré l’enthousiasme de Zhoya pour une tenue mixte, l’organisation des Jeux a précisé qu’il devait choisir entre le pantalon ou la jupe, mais pas les deux. Cette décision souligne les limites qui persistent dans l’acceptation des expressions de genre non conventionnelles, même dans des contextes qui se veulent inclusifs et modernes.