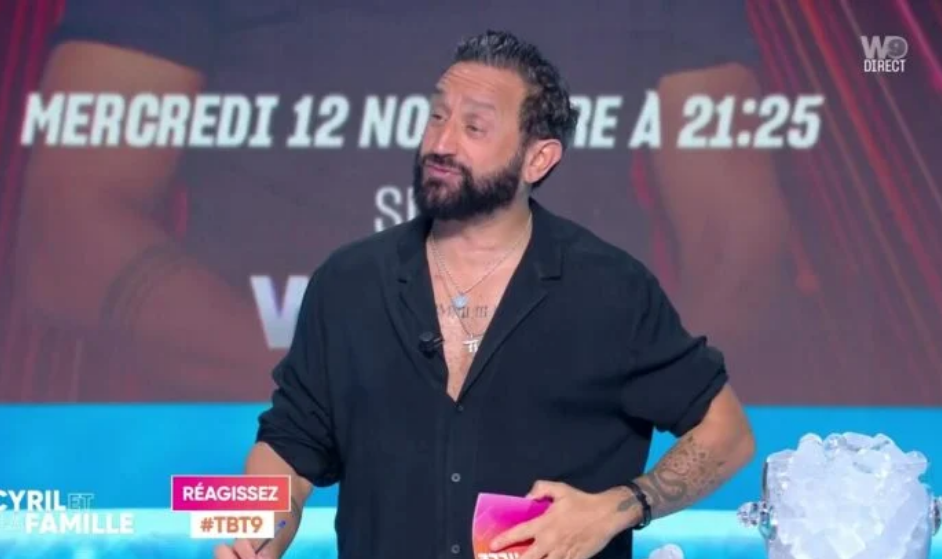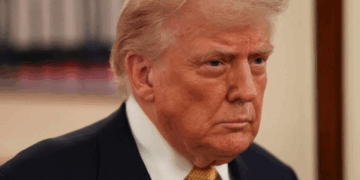Une propriétaire disposant de plusieurs biens immobiliers a perçu le RSA pendant plusieurs mois, malgré des revenus locatifs importants. Repérée par la CAF, elle a été sommée de rembourser plus de 11 000 euros. Ce cas met en lumière le renforcement des contrôles sur les bénéficiaires d’aides sociales et les limites de la transparence déclarative.
L’affaire, rendue publique par Actu Paris, remonte à deux périodes précises : de mai à octobre 2020, puis en juillet et août 2022, une femme âgée de 52 ans a perçu le Revenu de solidarité active (RSA), tout en encaissant des loyers issus de trois logements, situés à Paris et à Mulhouse. Le montant total perçu via ces locations s’élève à près de 49 000 euros sur deux ans, une somme bien au-delà des plafonds permettant de prétendre à cette aide sociale.
Le RSA est une prestation de dernier recours, destinée aux personnes disposant de ressources très faibles, voire nulles. Son attribution repose sur une déclaration honnête et exhaustive de l’ensemble des revenus, y compris les revenus locatifs. En 2025, le montant maximal du RSA s’élève à 646,52 euros pour une personne seule et jusqu’à 1 357,70 euros pour un couple avec deux enfants.
Une fraude repérée par les virements bancaires
C’est grâce à l’examen des relevés bancaires de la bénéficiaire que la Caisse d’allocations familiales (CAF) a repéré l’anomalie. Les virements réguliers en provenance des locataires ont éveillé les soupçons des services de contrôle. La CAF a alors constaté que les ressources de la propriétaire dépassaient largement le seuil autorisé pour bénéficier du RSA.
L’organisme a engagé une procédure de recouvrement, et l’affaire a été portée devant le Tribunal administratif de Paris. En avril 2025, la décision est tombée : la quinquagénaire devra restituer 11 500 euros, somme correspondant aux aides perçues à tort.
Une défense jugée peu convaincante par la justice
Face à la juridiction, la propriétaire a tenté de se justifier en expliquant qu’une part des loyers était reversée à son ex-conjoint. Mais aucune preuve concrète n’a pu appuyer cette affirmation, ni document bancaire, ni accord écrit. Les juges ont donc estimé que les revenus devaient être intégralement pris en compte, rejetant la tentative de défense.
Le code de l’action sociale et des familles est clair : seuls les revenus déclarés et justifiés permettent l’accès aux allocations sociales. Même en cas de séparation ou de versements à des tiers, des pièces justificatives sont obligatoires pour faire valoir une réduction effective de ressources.
Des contrôles de plus en plus systématiques
Cette affaire illustre la montée en puissance des contrôles menés par la CAF, notamment via le croisement automatisé de données. Les services peuvent accéder aux relevés bancaires, aux fichiers fiscaux ou encore aux informations des bailleurs sociaux pour détecter les incohérences entre les déclarations et la réalité financière des allocataires.
En cas de fausse déclaration ou d’omission volontaire, plusieurs sanctions sont possibles :
Remboursement intégral des sommes perçues,
Suspension des aides,
Poursuites pénales, dans les cas les plus graves, avec des peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.
PUBLICITÉ:
Ce cas met en lumière un enjeu central : préserver la légitimité des aides sociales en luttant contre les abus. Pour les allocataires de bonne foi, ces contrôles renforcent la confiance dans le système ; pour les fraudeurs, ils rappellent que l’opacité financière ne garantit plus l’impunité.