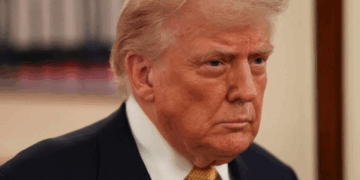Alors qu’Emmanuel Macron appelait au début de l’année à un « réarmement démographique » pour faire face au vieillissement de la population, les chiffres de l’Ined publiés ce mercredi 9 juillet dressent un tout autre constat : la France s’enfonce dans une crise durable de la natalité, portée par un changement profond des aspirations et des représentations autour de la parentalité.

Entre 2014 et 2024, le taux de fécondité en France est passé de 2,0 à 1,6 enfant par femme, franchissant un seuil critique pour le renouvellement des générations. Loin d’un accident conjoncturel, cette baisse s’inscrit dans une dynamique structurelle, révélant une mutation des désirs individuels et collectifs. L’Ined constate une déconnexion croissante entre les politiques natalistes et la réalité des choix des jeunes générations.
Les jeunes adultes souhaitent moins d’enfants
Chez les femmes de moins de 30 ans, le nombre moyen d’enfants souhaités a chuté de 2,5 à 1,9, une baisse considérable en à peine deux décennies. Si la famille avec deux enfants reste la norme majoritaire dans l’imaginaire collectif, elle est désormais perçue comme un plafond plutôt qu’un plancher. En 2024, 65 % des 18-49 ans estiment que deux enfants est le « nombre idéal », contre seulement 47 % en 1998. La norme glisse doucement vers un équilibre plus restreint, où la parentalité devient un choix raisonné, voire réservé à certains.
Les familles nombreuses en voie de disparition

Le déclin du désir de familles nombreuses est encore plus frappant. En 1998, la moitié des Français de 18 à 49 ans souhaitaient trois enfants ou plus. En 2024, ils ne sont plus que 29 %. Chez les jeunes de 18 à 29 ans, la tendance est encore plus marquée : seuls 10 % des hommes et 16 % des femmes souhaitent trois enfants, quand 20 % des jeunes hommes et 14 % des jeunes femmes se contenteraient d’un seul. Ce basculement laisse entrevoir une descendance finale nettement réduite pour les générations nées après 1985, selon les prévisions de l’Ined.
Une inquiétude généralisée face à l’avenir

Mais qu’est-ce qui pousse les Françaises et Français à revoir à la baisse leur désir d’enfants ? Pour l’Ined, la baisse des intentions de fécondité n’épargne aucun groupe social : elle touche toutes les catégories, sans distinction de sexe, d’âge, de niveau de diplôme, de milieu socio-économique ou d’origine. Ce qui évolue, en revanche, ce sont les représentations et les inquiétudes face à l’avenir.
La crise climatique, la dégradation des conditions économiques, la peur d’un avenir plus sombre pour les générations futures, l’angoisse démocratique, voire les mutations géopolitiques, sont autant de facteurs freinant le désir d’enfanter. Parmi les personnes très inquiètes pour l’avenir, seules 35 % envisagent d’avoir (ou d’avoir encore) un enfant, contre 46 % chez les moins inquiètes.
L’égalité des sexes, une variable inattendue
Autre point soulevé par les chercheurs : les personnes adhérant à une vision égalitaire des rôles hommes-femmes ont tendance à envisager moins d’enfants. Une donnée qui souligne l’enjeu logistique et mental de la parentalité dans une société où la charge reste encore très majoritairement portée par les femmes. Ce constat renvoie à une dissonance persistante entre les aspirations égalitaires et les réalités concrètes de la vie familiale.
Une France à l’heure du basculement démographique

Alors que le président de la République appelait à « refaire des enfants », la société française semble avoir déjà pris une autre direction. Dans un monde perçu comme instable, incertain et peu accueillant pour les générations futures, le repli démographique n’est plus seulement une tendance, mais un choix réfléchi. Il ne s’agit plus d’un manque d’incitations, mais d’un désengagement collectif et générationnel vis-à-vis d’un modèle de vie longtemps présenté comme universel.
Si les discours politiques plaident pour une relance nataliste, les chiffres de l’Ined rappellent qu’on ne commande pas aux désirs individuels à coup de slogans. La réponse, si réponse il y a, devra passer par une transformation structurelle des conditions de vie, du modèle familial et des politiques de soutien à la parentalité.