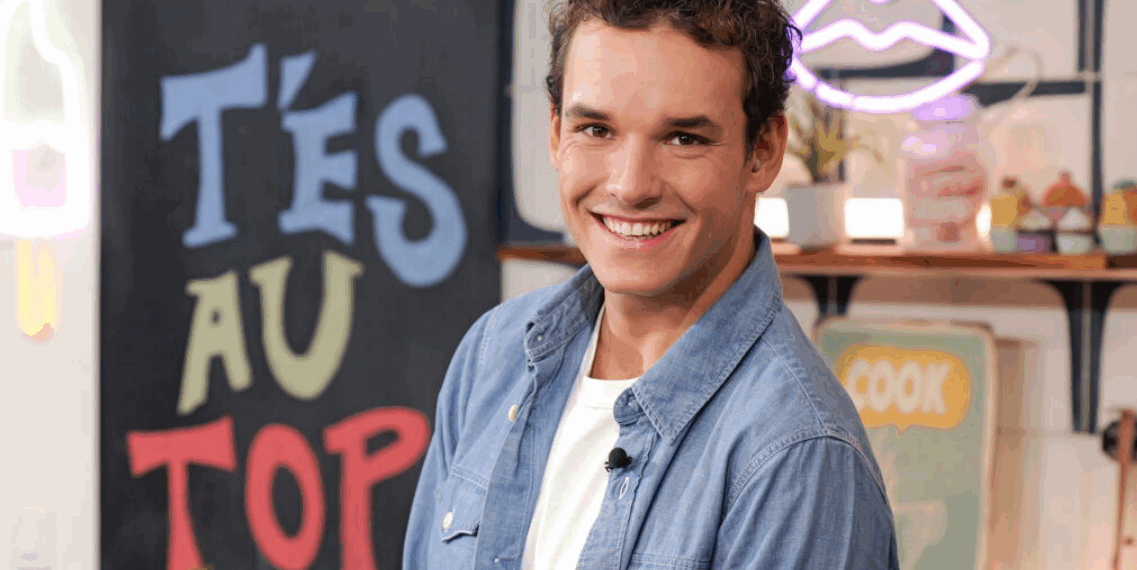Le procès de Dahbia Benkired, accusée du meurtre de la jeune Lola Daviet, se poursuit à Paris. Les experts médico-légaux, entendus à la barre, livrent des analyses précises et parfois éprouvantes sur les circonstances du drame, revenant sur les blessures constatées et les causes exactes du décès de l’adolescente.
Le 14 octobre 2022, le corps sans vie de Lola Daviet, âgée de 12 ans, est retrouvé dans une malle, dans la cour de son immeuble du 19ᵉ arrondissement de Paris. L’émotion est immédiate, tant le choc dépasse l’entendement des habitants et des proches. Le lendemain, la dépouille est transférée à l’institut médico-légal pour un examen complet confié au docteur Isabelle Sec, spécialiste reconnue en médecine légale.
Lors de son témoignage au procès, la praticienne a précisé que le corps de la fillette est arrivé « dans un bon état de conservation », enveloppé dans une couverture de survie. Elle ajoute avoir observé la présence de ruban adhésif sur le visage, qui n’était plus visible au moment des opérations médico-légales. Ces détails, dit-elle, ont été cruciaux pour comprendre les conditions exactes du drame.
Les conclusions des médecins légistes
L’experte a ensuite décrit avec précision les résultats de son examen. Elle a recensé trente-huit plaies sur le corps de la victime, notamment à l’arrière du thorax et sur le bas du visage. Certaines atteintes présentaient des signes d’hémorragie interne, tandis qu’une fracture de la mâchoire gauche a également été relevée. En revanche, aucune marque de défense n’a été constatée sur les mains, laissant penser que l’enfant n’a pas eu le temps de se protéger.
Selon le rapport médico-légal, la cause du décès est une asphyxie due à l’obstruction des voies respiratoires supérieures, provoquée par du ruban adhésif appliqué sur le nez et la bouche. Un scénario confirmé par plusieurs éléments d’analyse, qui tendent à démontrer une perte rapide de conscience.
Une asphyxie jugée particulièrement angoissante
Interrogée sur la souffrance ressentie par la jeune victime, la docteure Sec a répondu avec une gravité palpable : « Avant la perte de connaissance, l’asphyxie est une expérience extrêmement angoissante, bien au-delà de la douleur physique ». Elle a estimé que l’agonie aurait pu durer deux à trois minutes, un laps de temps court mais d’une intensité dramatique.
Cette déclaration a particulièrement ému les parties civiles, qui cherchent à comprendre les derniers instants de l’enfant. Pour les parents, cette étape du procès est essentielle : savoir si leur fille a souffert demeure une question centrale.
Des constatations supplémentaires évoquées au procès
L’expertise du professeur Patrick Barbet, en charge de l’examen anatomo-pathologique, a révélé d’autres lésions situées dans les zones intimes de la victime. Ces marques, survenues dans les heures précédant le décès, présentent des traces d’infiltration sanguine. Toutefois, les experts n’ont pu déterminer avec certitude l’origine exacte de ces blessures, ni s’il s’agissait d’une agression commise avec un objet ou autrement.
Le docteur Sec a insisté sur la prudence nécessaire dans l’interprétation : « Rien ne permet d’affirmer la nature précise de ces lésions. Nous savons seulement qu’elles ont été causées avant la mort. » Ce passage, particulièrement sensible, a été évoqué avec une grande retenue par la cour.
Les réponses de l’accusée devant la cour d’assises
Face à ces révélations, Dahbia Benkired, âgée de 27 ans, a été invitée à réagir par le président de la cour. Elle a d’abord déclaré ne pas avoir tout compris aux termes techniques employés, en raison, selon elle, de sa maîtrise imparfaite du français. Elle a néanmoins affirmé : « Je n’ai rien à dire. Je n’ai rien fait. »
Lorsque le juge a évoqué les contradictions entre ses déclarations et les constatations des experts, notamment concernant le nombre de coups portés et la nature des blessures, l’accusée a maintenu sa position : elle nie toute violence de cette nature, tout en reconnaissant certains gestes contraints de nature sexuelle.
Un échange tendu avec le président du tribunal
Le magistrat a tenté de comprendre comment les lésions constatées avaient pu apparaître si personne d’autre n’était présent dans l’appartement. Les questions se sont succédé : « Y avait-il quelqu’un d’autre ? » — « Non », répond l’accusée. — « Comment alors expliquer ces blessures ? » — « Je n’en ai aucune idée », répète-t-elle, avant d’assurer qu’elle aurait dit la vérité si elle avait commis ces actes.
Le ton demeure mesuré, mais les contradictions persistent. La cour cherche à démêler les zones d’ombre d’une affaire qui, depuis deux ans, bouleverse profondément l’opinion publique et la famille de la victime.
Un procès scruté avec émotion et gravité
Ce procès, suivi avec une attention nationale, met en lumière la complexité d’un drame où se mêlent douleur, incompréhension et quête de vérité. Les audiences se succèdent, les experts se relayent à la barre, et les avocats des parties civiles rappellent l’importance de rendre justice à une enfant partie trop tôt, dans des circonstances d’une rare tristesse.